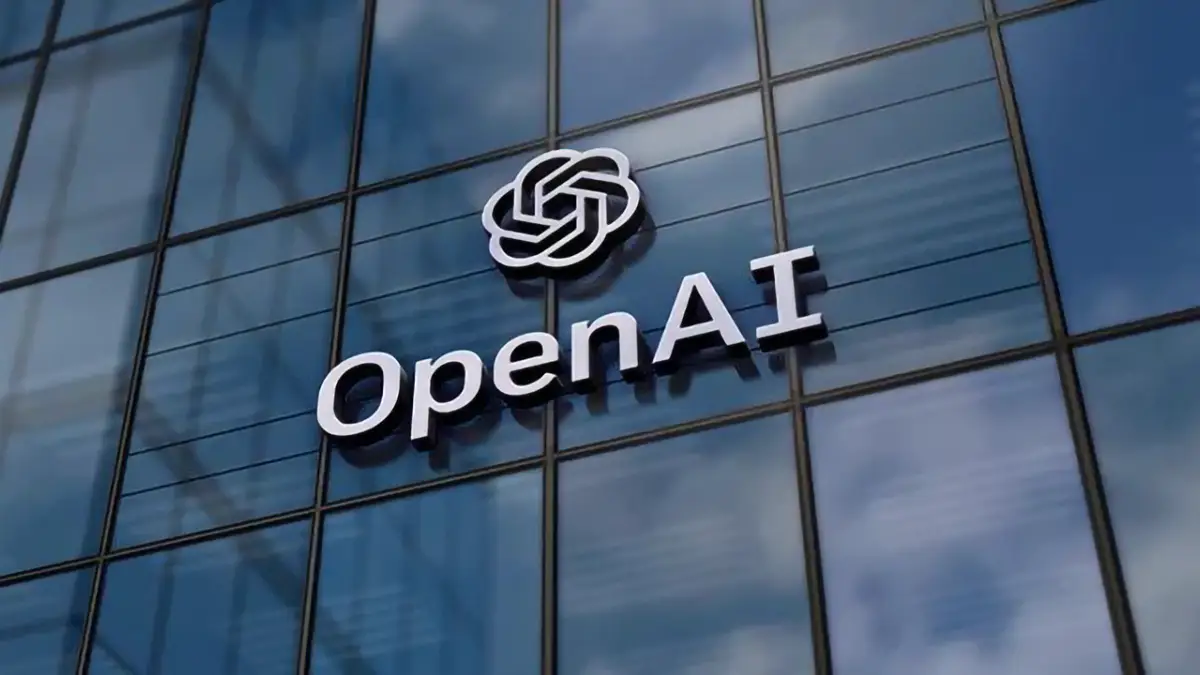Un projet démesuré, porté par OpenAI et ses alliés, prend forme aux Émirats. À la clé, un campus de données plus vaste que Monaco, capable d’alimenter l’intelligence artificielle avec la puissance de cinq réacteurs nucléaires.
À ce niveau de grandeur, les comparaisons cessent d’être métaphoriques. Ce que prépare OpenAI à Abu Dhabi dépasse les dimensions habituelles de l’industrie technologique. Un centre de données de 10 miles carrés, soit plus grand que la Principauté de Monaco, avec une capacité énergétique de cinq gigawatts. Une échelle rarement atteinte, même dans les fantasmes d’infrastructure. Et pourtant, ce n’est pas un rêve. C’est un chantier bien réel, qui cristallise déjà des tensions, des ambitions et des calculs géopolitiques.
Le projet, baptisé Stargate, s’inscrit dans une alliance stratégique entre OpenAI, le conglomérat émirati G42 et, dans une certaine mesure, Microsoft, actionnaire majeur de la startup californienne. Stargate n’est pas un simple entrepôt de serveurs. C’est une promesse de souveraineté numérique, une vitrine de puissance algorithmique, et un levier d’influence globale. Si le premier site prévu à Abilene, au Texas, plafonne à 1,2 gigawatt, la déclinaison d’Abu Dhabi en quadruplerait la capacité. De quoi abriter, faire tourner et entraîner des modèles d’IA à une échelle jamais vue.
Rien n’est anodin dans ce choix d’implantation. Depuis 2023, OpenAI entretient une relation croissante avec les Émirats. G42, son partenaire local, n’est pas un acteur neutre. Fondé en 2018, le groupe est présidé par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats, le cheikh Tahnoon ben Zayed Al Nahyane, frère du souverain actuel. Cette proximité politique, associée à des liens antérieurs avec des entités chinoises controversées comme Huawei ou le Beijing Genomics Institute, avait déjà suscité la méfiance de Washington. Des doutes accentués par la crainte que certaines technologies de pointe ne soient détournées ou récupérées par des puissances rivales.
Face à la pression américaine, G42 a annoncé début 2024 une rupture nette avec ses engagements en Chine. « Tous nos investissements dans ce pays ont été cédés », a déclaré son directeur. Une déclaration à visée rassurante, certes, mais insuffisante pour dissiper tous les soupçons. L’entrée de Microsoft au capital de G42, à hauteur de 1,5 milliard de dollars, et la nomination de son président Brad Smith au conseil d’administration, ont été perçues comme une tentative d’encadrement. Rester proche pour mieux contrôler. Mais le flou persiste.
Ce qui frappe, au-delà des jeux d’alliances, c’est l’échelle presque extravagante du projet. À quoi bon une telle puissance de calcul concentrée dans une seule zone géographique ? Certains y verront une anticipation rationnelle de la demande future, un pari sur le prochain palier de l’IA générative, plus gourmand que jamais en ressources matérielles. D’autres y décèleront une volonté de verrouiller l’infrastructure mondiale, de rendre OpenAI incontournable dans la chaîne de valeur algorithmique. Tout en testant un nouveau modèle d’implantation : hors sol, hors États-Unis, hors circuit classique.
Il y a aussi, dans ce projet, une forme d’audace assumée. Sam Altman lui-même n’a jamais caché son admiration pour la stratégie proactive des Émirats. « Ils parlaient d’intelligence artificielle avant que ce soit à la mode », déclarait-il en 2023. Une phrase banale sur le fond, mais révélatrice d’un alignement stratégique. Là où d’autres hésitent, Abu Dhabi avance, finance, construit. Peu importent les controverses, pourvu que l’agenda technologique progresse.
Reste une question difficile à contourner. À qui profitera réellement cette puissance ? Les modèles d’OpenAI seront-ils accessibles depuis cette infrastructure, ou réservés à des usages plus discrets, plus régionaux ? Quelle souveraineté réelle garde l’entreprise californienne lorsqu’elle installe ses fondations dans un pays où les intérêts technologiques et sécuritaires sont intimement liés ? Et surtout, ce pari énergétique colossal est-il compatible avec les engagements climatiques que les géants du numérique revendiquent par ailleurs ?
La frontière devient floue entre innovation et stratégie d’influence. Ce que l’on croyait réservé aux États – la maîtrise d’un territoire, la possession d’une puissance énergétique autonome, l’exportation d’une technologie à fort impact – devient peu à peu le terrain de jeu de quelques entreprises mondialisées. OpenAI, en s’ancrant durablement dans les infrastructures physiques du Moyen-Orient, change de dimension. Le cloud, jadis évanescent, devient territoire. Avec ses frontières, ses tensions, ses lignes de fracture.
Et à mesure que l’intelligence artificielle se matérialise dans ces fermes de données géantes, il devient plus difficile de prétendre que tout cela ne serait qu’un outil.