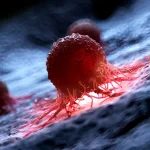Au Québec, alors que l’obésité infantile progresse et que les réponses institutionnelles tardent à suivre, des programmes comme Circuit+ offrent à quelques familles une expérience qui change le quotidien, bien au-delà des chiffres et des diagnostic
Daven Mailloux n’aurait sans doute pas imaginé, il y a un an à peine, que l’escalier de son immeuble deviendrait le théâtre discret d’une métamorphose familiale. Chaque jour à la même heure, sa mère déclenche une alarme sur son téléphone : il est temps pour Daven de gravir, puis de redescendre, les treize marches qui séparent leur salon du palier supérieur. Un geste simple, mais qui prend un sens particulier lorsqu’on sait qu’à 12 ans, il se battait déjà contre une stéatose hépatique, ce « foie gras » qui mine lentement la santé des enfants atteints d’obésité. Avant d’intégrer Circuit+, Daven bougeait peu. Manger devenait une routine sans plaisir, dominée par la facilité du fast-food et la fatigue de sa mère, seule, elle-même fragilisée par la douleur chronique. La vie tournait autour de solutions rapides, de plats industriels, de douceurs consommées pour calmer des émotions plus profondes.
Le programme Circuit+, lancé en projet pilote à Rimouski et à Terrebonne, s’adresse à ces enfants pour qui l’obésité n’est pas une statistique, mais une réalité complexe, mêlant troubles alimentaires, anxiété, isolement social, voire diabète ou difficultés motrices. Son principe repose sur un accompagnement personnalisé, où une kinésiologue, soutenue par une nutritionniste et une psychoéducatrice, suit chaque famille durant plusieurs mois. Ici, il ne s’agit pas de prescrire des régimes miracles ni de promettre des transformations spectaculaires. On commence par des gestes minimes : manger un raisin par jour, réintroduire les légumes, réapprendre à cuisiner ensemble. Progressivement, ces micro-changements s’accumulent, jusqu’à modifier en profondeur le rapport au corps et à l’alimentation.
Les résultats ne se lisent pas toujours sur la balance. Daven n’a pas maigri, mais il a stabilisé son indice de masse corporelle, ce qui représente déjà une victoire majeure selon le pédiatre du programme. À l’adolescence, la courbe de l’IMC peut s’emballer si rien ne freine les habitudes néfastes. Pour certains, tenir bon, éviter la progression de la maladie, c’est gagner du temps précieux sur des complications irréversibles : hypertension, atteintes hépatiques, voire greffe future. Le suivi ne se limite pas à l’activité physique. Les familles reçoivent des conseils sur le sommeil, l’usage des écrans, la gestion du stress. Des ateliers sont proposés, parfois à distance, pour donner des repères sans jugement. Le regard posé sur ces jeunes n’a rien de moralisateur ; il s’agit de soutenir sans condamner, d’accompagner dans la durée.
Cependant, la réalité des moyens impose sa limite. À Rimouski, une seule kinésiologue gère la trentaine de jeunes inscrits. Les ateliers sont rares, les rendez-vous espacés, et treize enfants attendent encore une place. Un quart des participants abandonnent en cours de route, parfois découragés par le manque de résultats visibles, parfois rattrapés par les difficultés sociales ou financières. Nadia Mailloux, la mère de Daven, avoue avoir longtemps « mangé ses émotions ». Le retour à la cuisine maison, aux plats mijotés, a marqué une étape autant psychologique que nutritionnelle. Elle aurait souhaité un accompagnement plus long, une continuité qui dépasse la parenthèse du projet pilote.
Elle aurait souhaité un accompagnement plus long, une continuité qui dépasse la parenthèse du projet pilote. Comme le montre ce reportage de terrain sur le quotidien de familles québécoises confrontées à l’obésité infantile, les effets du programme Circuit+ dépassent largement le cadre médical.
L’expérience de Jeffrey-Lou St-Hilaire, 18 ans, éclaire un autre pan de cette réalité. Atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et de diabète de type 2, passionné de dek hockey, il lutte pour intégrer de nouvelles habitudes, comme le petit-déjeuner ou la lecture des étiquettes alimentaires. Les progrès sont inégaux. Son tour de taille augmente malgré ses efforts, mais sa glycémie s’améliore. Les victoires sont parfois invisibles, ou simplement diffuses : une plus grande autonomie, une estime de soi qui se reconstruit, le plaisir retrouvé dans l’effort. L’un des défis majeurs demeure la gestion des écrans : plusieurs appareils restent allumés en même temps, et la réduction du temps passé devant la console relève du parcours d’obstacles. Ici encore, l’approche se veut progressive, sans contraintes autoritaires.
Ce qui se joue dans ces familles, c’est un apprentissage de la patience et de la résilience. Les progrès suivent le rythme de la vie : une blessure au sport, une période difficile à l’école, et tout peut être remis en question. Le chemin n’est jamais rectiligne, ni garanti. Pourtant, chaque pas compte. Au fil des mois, Daven et sa mère font une marche quotidienne dans le quartier. Il est plus à l’aise en éducation physique. Il ose des acrobaties sur le trampoline, se découvre des envies de mouvement. Le regard sur lui-même change peu à peu.
Au-delà de ces histoires individuelles, la question du statut de l’obésité en tant que maladie chronique reste en suspens au Québec. Malgré un consensus international récent, qui propose d’inclure le tour de taille et les complications associées dans la définition médicale, la reconnaissance officielle tarde à venir. Cela prive des milliers d’enfants d’un suivi adapté, alors que les chiffres continuent d’alerter : 10 % des enfants québécois sont concernés, près d’un tiers présentent un excès de poids au Canada, et la majorité des adolescents obèses le resteront à l’âge adulte.
Ce que racontent Nadia, Daven, Jeffrey-Lou et les autres, c’est la nécessité d’un accompagnement patient, incarné, loin des slogans et des solutions magiques. Le changement ne tient parfois qu’à une poignée de gestes, à la ténacité d’une équipe, à la solidarité d’un quartier ou à la volonté discrète d’une mère. Circuit+ n’est pas la réponse à tout, mais il montre que, même dans un contexte de ressources limitées, il est possible d’amorcer une transformation. Pas de miracle, pas de recette, juste la vie qui reprend, marche après marche, dans la fragilité et la dignité retrouvée.