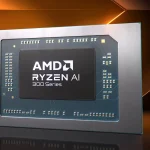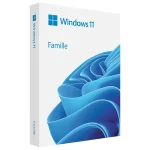Une nouvelle analyse de sursauts gamma suggère que la plus grande structure de l’univers s’étend bien au-delà des limites théoriques. De quoi faire vaciller les piliers de la cosmologie moderne.
Il y a des murs qu’on voit venir, d’autres qui surgissent là où l’on pensait l’univers uniforme. Le Grand Mur d’Hercule–Couronne Boréale appartient clairement à la seconde catégorie. À peine digéré par la communauté scientifique depuis sa première identification en 2014, le voilà qui revient, plus massif, plus long, plus gênant encore.
Les dernières estimations lui attribuent une extension d’environ 15 milliards d’années-lumière. Une démesure qui dépasse l’entendement, et surtout les seuils posés par le fameux principe cosmologique. Ce dernier stipule, en théorie, que l’univers est homogène à grande échelle. En clair, au-delà d’un certain point, les choses devraient se ressembler. Pas de gros amas, pas de surdensité, pas de mur. Mais ici, le mur est là. Immense. Et bien réel.
À l’origine de cette réévaluation, une équipe d’astronomes menée par István Horváth, Jon Hakkila et Zsolt Bagoly. Leur méthode ? Les sursauts gamma. Ces flashs de lumière violents, souvent issus de la mort d’étoiles massives ou de la collision de noyaux denses comme les étoiles à neutrons, sont autant de balises lumineuses plantées dans les profondeurs de l’univers. En scrutant leur répartition, les chercheurs ont cartographié ce qui ressemble à une concentration galactique géante. Plus exactement, ils ont analysé 542 sursauts répartis sur un décalage spectral allant de 0,33 à 2,43. Le résultat est sans appel : le mur est encore plus vaste que ce que l’on croyait, comme le suggère cette animation.
Ce qui dérange, ce n’est pas seulement sa taille. C’est ce qu’elle implique. Des structures de cette envergure ne devraient tout simplement pas exister si l’on en croit nos modèles actuels. Pourtant, d’autres formations comme la Grande Muraille de Sloan ou le Quipu avaient déjà semé le doute. Ce mur-ci les surpasse tous, de loin.
Alors bien sûr, certains sceptiques ont tenté de minimiser son importance. On a parlé d’anomalie statistique, d’erreur d’échantillonnage. Mais avec cette nouvelle étude, les doutes s’effritent. L’objet est trop cohérent, trop net, trop persistant. Le Grand Mur est là, et il ne se contente pas de bloquer la lumière : il remet en cause notre manière de penser l’univers.
Il reste beaucoup de questions en suspens. Ce mur raconte-t-il un pan méconnu de l’histoire cosmique ? Est-il le signe que nos instruments théoriques doivent être revus ? Ou n’est-il qu’un rappel, spectaculaire et silencieux, que le cosmos a encore des secrets bien gardés ?